Qu’est-ce que la terre, selon le folklore français ?

1. Sa nature originelle

Dans les campagnes, la forme de la Terre préoccupait beaucoup moins les paysans que la nature du ciel. Leur curiosité restait souvent limitée aux particularités de leur environnement immédiat : collines, vallées, cours d’eau ou rochers singuliers. Rares étaient ceux qui s’interrogeaient sur l’ensemble du globe, et encore moins sur sa place dans l’univers. Les récits folkloriques recueillis en Bretagne ou ailleurs témoignent surtout d’une vision locale, où l’horizon représentait une frontière naturelle et presque infranchissable.
Les enquêtes menées hors de Bretagne – souvent concordantes avec celles de la région – donnent un aperçu assez homogène de ces croyances rurales. Selon ces conceptions :
2. Idées populaires
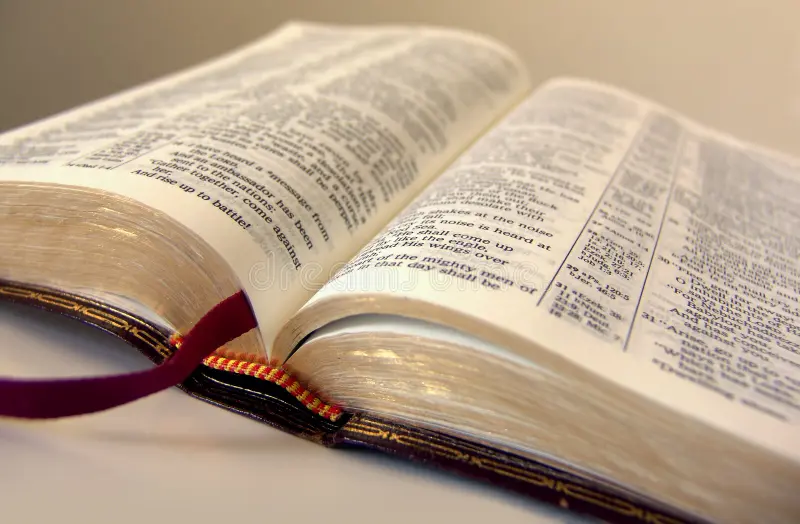
Dans les campagnes françaises du XIXᵉ siècle, beaucoup ignoraient encore la révolution de la Terre. Ils restaient fidèles à l’antique croyance qui en faisait le pivot immobile de l’univers. Quand on leur affirmait que la Terre n’était en réalité qu’un minuscule point dans l’immensité, plus petit que de nombreuses étoiles, certains pensaient qu’on se moquait d’eux. L’idée d’un globe tournant paraissait encore plus absurde : « Si c’était vrai, il y aurait des hommes qui marcheraient la tête en bas », disaient-ils. Une objection qui n’était pas propre à la France : des peuples, comme les Kamtschadales, formulaient la même remarque.
Une idée largement partagée voulait que la Terre soit entourée par la mer. Dans le Mentonnais, certains allaient plus loin et soutenaient une théorie proche de celle du philosophe Thalès : la Terre flotterait sur l’eau comme un navire. D’autres affirmaient qu’elle reposait sur des piliers. Cette vision se retrouve en Bretagne dans une légende selon laquelle la ville de Quimper est construite sur quatre colonnes de sureau.
Les traditions sur l’origine du globe, présentes chez de nombreux peuples, semblaient absentes en France. Le christianisme avait sans doute effacé ces récits, ne laissant que l’explication biblique de la Création. Toutefois, en Bretagne, on retrouvait une nuance : Dieu aurait façonné la Terre, tandis que le Diable, en contrepartie, aurait créé les eaux pour tenter de la submerger.
Les récits de changements postérieurs à la Création sont rares. Une légende de l’Albret raconte que la Terre était autrefois plane « comme un parquet » jusqu’à un déluge. Lorsque les eaux se retirèrent, elles laissèrent derrière elles des vallées, des collines, des lacs et des montagnes. Selon cette croyance, la Terre redeviendra plane à la fin des temps.
Ces idées populaires sur la Terre montrent une vision générale assez floue et de peu d’intérêt scientifique. Pourtant, lorsqu’il s’agit de paysages, de rivières, de rochers ou de phénomènes naturels, les traditions sont innombrables. C’est dans ces récits locaux que se révèle toute la richesse de l’imaginaire paysan.
3. Particularités régionales

Les explications populaires sur la configuration des régions sont rares, mais elles ne manquent pas d’imagination. Dans le Nivernais, on racontait que le Berry était devenu un pays plat grâce à l’intervention du géant Pousse-Montagne. Ce dernier serait passé peu après Gargantua, et, pour aplanir le sol, il aurait comblé de terre les creux laissés par les pas du colosse. Cette vision rejoint l’imaginaire facétieux que La Fontaine met en scène dans un de ses textes pour expliquer l’aspect uniforme de la Beauce. Là encore, l’idée repose sur un jeu de contraste entre plaines immenses et régions montagneuses voisines. Voici un extrait de cette version poétique :
« La Beauce avait jadis des monts en abondance,
Comme le reste de la France ;
Mais ses habitants demandèrent au Sort
… de leur ôter la peine
De monter, de descendre et de monter encor… »
Le Sort, un brin moqueur, exauça leur vœu à sa manière : les monts disparurent du paysage, mais les habitants devinrent bossus. Et comme il fallait bien placer les montagnes déplacées, Jupiter décida de les installer non pas en Touraine, mais dans le Limousin.
Dans d’autres régions, c’est la désolation du sol qui a suscité des légendes. Selon Strabon, dans son livre Géographie, des auteurs tels que Aristote et Posidonius ont avancé des arguments rationnels à la désolation particulière de la plaine de Crau ; mais le souvenir d’une fable d’Eschyle à transformer une simple remarque en futur croyance. Voici ce qu’écrivait Eschyle :
« Puis tu rencontreras l’intrépide armée des Ligyens, et, si grande que soit ta vaillance, crois-moi, elle ne trouvera rien à redire au combat qui t’attend : à un certain moment (c’est l’arrêt du destin) les flèches te manqueront, sans que ta main puisse trouver sur le sol une seule pierre pour s’en armer, car tout ce terrain est mou. Heureusement, Jupiter aura pitié de ton embarras, il amassera au-dessous du ciel de lourds et sombres nuages, et fera disparaître la surface de la terre sous une grêle de cailloux arrondis, nouvelles armes qui te permettront alors de disperser sans peine l’innombrable armée des Ligyens. »
Strabon, Géographie, livre IV, chapitre 1, §7
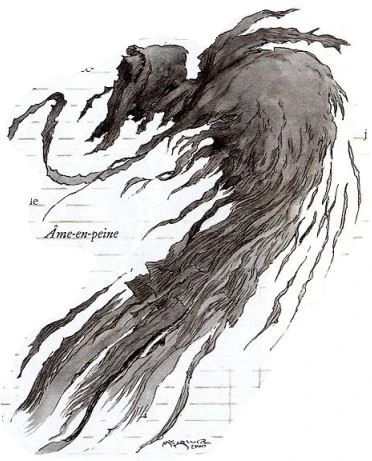





Laisser un commentaire